Actuellement, on parle beaucoup de l’avenir de la littérature. Ça m’a donné pour le coup l’envie de découvrir son passé. Alors ni une ni deux, voici un petit récapitulatif sur l’origine des romans, rien que pour vous.
Déjà, soyez prévenus, on ne va faire que survoler de loin le sujet. Si je le désirais, je pourrais aborder les mouvements, les différences nationales, les influences entre civilisations, mais ça me prendrait des heures et des pages. En plus, si je veux éviter de dire trop de conneries, j’ai tout intérêt à resserrer au maximum le sujet.
Tiens, par exemple, vous saviez que l’un des candidats au titre de premier roman de l’Histoire est le Genji Monogatari, le dit du Genji, un ouvrage japonais du XIe siècle ? Voilà. Ça sera tout ce que je mentionnerai concernant les romans hors de l’Europe, et on gardera l’avis local que c’est Don Quichotte qui a bien mérité ce titre, même s’il n’arrive qu’en 1605. Grâce à moi, vous pourrez quand même briller un peu plus en société. Sympa.
Bon, commençons comme une rédac’ de philo au lycée, autrement dit, en définissant les termes. D’où vient le mot « roman » ? À l’origine, cela désignait tous les textes écrits en langue romane, l’héritière de la langue d’oïl, et qui s’opposaient aux textes en latin. Ainsi, au début, les romans étaient les livres de compte, les inventaires, et tout un tas de documents administratifs palpitants. Pour l’anecdote, au XIIe siècle, on disait « mettre en roman » pour « traduire en langue vulgaire ». (et après ça, on accusera encore les auteurs de faire du tell et du langage parlé, j’te jure)
Au début (i.e. au XIIe siècle), les romans sont encore en vers, et héritent des sujets pompeux de leurs ancêtres (le conte, la geste, la fable, et je t’en passe) : Chrétien de Troyes nous en fournit l’exemple parfait, avec toute la matière de Bretagne et la légende arthurienne. Du lyrique, du chevaleresque, du Beau-trouvé. Ça fleure bon l’or et l’encens.
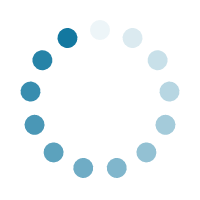
De l’épique et de la noblesse, je vous dis !
Au XIIIe siècle, cependant, on constate un glissement progressif de sujet. À cette époque, les lettrés redécouvrent les grecs anciens et leurs aventures, appelant à un renouveau de genre. Moins de chevaliers, de damoiselles en détresse et de lieux imaginaires, pour plus de marchands, de jeunes paysans et d’endroits connus. Quelque chose de plus vrai, de plus réaliste, de moins fab(u)leux. Ici débute une des grandes marques de fabrique du roman : une fiction qui fait vrai.
Les récits se tournent alors vers des sujets plus intimes, plus individuels. Moins de grandes batailles entre royaumes, et plus d’aventures où le héros apprend de belles leçons de vie. Les histoires ne sont plus faites pour être contées au coin du feu, ou lues à haute voix à tout un cercle d’auditeurs ; les lecteurs (et lectrices, les dames représentaient déjà une part importante du lectorat) vont s’isoler pour lire peinard. Pour réfléchir à ce qu’ils lisent. Pour se poser.
Les auteurs, eux aussi, vont prendre un peu de recul, penser à tout ça, et se dire quelque chose qui, à l’époque, a dû ressembler à ça : « hey mais j’y pense, les vers, les rimes, les octosyllabes et tout le patacoufin, c’est sympa, mais est-ce qu’on en a encore besoin ? » Tout cet attirail de versification servait jusque là d’astuce aux conteurs, qui mémorisaient ainsi des textes parfois très longs avec plus de facilité. Maintenant qu’on lit le texte tranquillement dans sa chambre, pour soi, ce besoin s’efface, et la prose s’invite dans la fiction.
S’ensuit toute une série de mouvements. Les Humanistes qui rejettent définitivement les romans de chevalerie. Les baroques, les galants, les picaresques, en veux-tu en voilà. On franchit ainsi allègrement plusieurs siècles de bordel sans nom. Ce n’est pas le sujet qui m’intéresse aujourd’hui, alors passons.
À partir du XVIIe siècle, et tout au cours du XVIIIe, le roman va subir une nouvelle transformation physique, qui commencera de l’autre côté de la Manche. L’équation est simple :
démocratisation massive de l’alphabétisation
+ des procédés d’impression de plus en plus répandus
+ du papier de moins en moins cher
= un énorme marché pour les bouquins de merde
C’est ainsi que vont apparaître les chapbooks, s’opposant aux belles lettres (en français dans le texte, s’il vous plaît). Il s’agit de bouquins tirés en masse, pas chers, jetables, minuscules (24 pages max, vu qu’on pliait une feuille pour les faire), et qu’on pouvait se procurer pour quelques piécettes. La qualité des textes suivait le même chemin et reprenait des textes de qualité mais… épurés. Ainsi, un chapbook de Robinson Crusoë se vantait de fournir tous les rebondissements de l’original sans les réflexions rasoir – et pour un prix dérisoire, ma bonne dame ! Venez encore me dire que c’est l’éditeur qui fait la littérature, tiens, pour de rire.
Et je ne vous parle même pas des illustrations, où c’était la foire à la saucisse la plus totale. Vas-y que je te colle le même dessin plusieurs fois, vas-y que je te fous du chevalier en armure lourde en face d’une d’un jeune noble en perruque (bah oui, vous comprenez, les xylographies, une fois qu’on les a faites, ça serait bête de les jeter et pas les réutiliser, tant pis si dans la foulée on crée un anachronisme de deux siècles).
Bref, le roman de gare inventé 150 ans avant la première locomotive. Malgré ce ravissant paradoxe temporel, les universitaires de l’époque méprisaient les chapbooks. Je ne saurais trop dire pourquoi.
Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour que le roman prenne sa forme actuelle, tant dans la forme que le fond. Ça paraît con à dire, mais ce n’est qu’alors que ce sont imposés les découpages en chapitre, le passé narratif, la présence du narrateur, et toutes ces choses. Rappelez-vous que le roman est le fils du conte et de la geste : des formes où la question de narration ne se posait jamais, puisque le conteur parlait à voix haute devant son auditoire.
Voilà pour le passé du roman. Et l’avenir, me direz-vous ? Peut-on tirer quelques enseignements du premier pour le second ? Sans doute.
Tout d’abord, que la forme physique du roman a toujours conditionné son contenu, et que l’inverse est également vrai.
Le prix du papier et les procédés d’imprimerie ont pesé sur la formes du roman, tout autant que les modes de lecture, seuls ou à plusieurs, en veillée près de la cheminée ou dans sa chambre. Un phénomène qu’on retrouve de nos jours avec l’arrivée de nouveaux formats, comme l’epub ou le weblivre, qui offrent aux novellas et aux feuilletons un regain de faisabilité, et dès lors d’intérêt. On peut publier à moindre frais des textes plus courts, pour une consommation sur le pouce.
Un livre, c’est avant toute chose un support de transmission, quel qu’il soit, et un support, ça offre des possibilités comme ça pose des limites. Faire ce constat, ça peut encourager à jouer avec le support pour influencer le message – je pense par exemple à la Radius Experience qui y va chaud les ballons.
Et je vais vous laisser avec une bien belle (fausse) tautologie : ce qui fait le roman, c’est le livre.
