Les éditeurs, qui sont-ils, d’où viennent-ils, que nous veulent-ils ? Après vous avoir bien appâtés avec ces interrogations dignes d’une Une du Point, je vous propose un petit exposé sur l’origine de ce métier qui n’est finalement pas si vieux que ça.
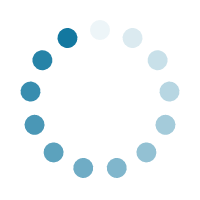
On va parler de barbus aujourd’hui, soyez avertis !
Commençons vite fait par le commencement. ~1450, Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (dit Jojo pour certains, Gutenberg pour d’autres), invente les caractères mobiles et démarre la première révolution du livre.
À l’époque, en l’absence de besoin de spécialisation, point d’éditeur : ce sont les libraires ou les imprimeurs qui se chargent de ça. La chaîne du livre est du coup super courte : l’auteur, et le libraire-imprimeur. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une chaîne, en fait. Il faut dire, les lecteurs ne sont pas super nombreux, les auteurs non plus, du coup ça va, on gère.
Hop, saut dans le temps (je suis auteur SF, je peux).
En 1694 : rien de follement neuf. Le mot « éditeur » ne figure pas encore dans la première édition du dictionnaire de l’Académie Française. Je ne saurais vous dire pour la seconde et la troisième (car, pour une raison qui m’échappe, ces deux éditions ne sont pas numérisées), mais dans la quatrième, en 1762, le mot « éditeur » est présent :
ÉDITEUR : celui qui prend soin de revoir & de faire imprimer l’ouvrage d’autrui.
Sobre, simple, basique, et avec l’abus d’esperluettes propre à l’époque. On retrouve déjà, sommairement, la notion de retour éditorial et d’exploitation de l’œuvre.
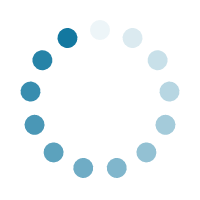
Il nous faut aller plus loin !
Nouveau saut temporel, plus petit cette fois.
Nous voici fin XVIIIe – début XIXe. La révolution industrielle arrive, et entraîne dans son sillage de suif et de cambouis la seconde révolution du livre. Je coupe mon convecteur temporel, c’est la période qui nous intéresse. Et accrochez-vous à votre slip, parce qu’il va s’en passer, des choses.
Point de départ : l’alphabétisation des masses. Les estimations en sont complexes, différentes entre les sexes, les régions, et elles se basent la plupart du temps sur le nombre de signatures sur les actes de mariage (un indicateur comme un autre), mais en gros, on passe de ~50% de lettrés vers 1800 à ~75% vers 1860. Boum. Et ces gens veulent s’instruire et lire, avec ça.
En conséquence, l’imprimerie connaît une croissance inégalée jusqu’alors. Pour suivre la demande, les procédés évoluent, et on passe d’une impression à la papa à des méthodologies industrielles : fabrication du papier en continu, mécanisation des presses, arrivée des rotatives, machines à composer, etc.
Les imprimeurs ont donc bien d’autres chats à fouetter que faire le boulot d’éditeur, d’autant que la presse devient leur principal client – je n’en ai aucune preuve, mais ce n’est sans doute pas un hasard si la presse tire son nom d’une pareille métonymie. Ce sont donc principalement les libraires qui, en contact direct avec le lectorat, vont prendre le relais. Ça sera par exemple le cas de Hachette en 1826 (encore aujourd’hui le plus gros trust en France) ou Flammarion en 1876.
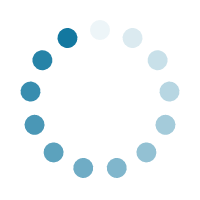
« Nous, aux Imprimeries Cogip, on a autre chose à faire que de s’occuper des écrivaillons »
Paradoxalement, cette envolée économique côté imprimeurs s’accompagne côté auteurs de la disparition des mécénats traditionnels, privés, publics, ou religieux. Il a fallu trouver de nouveaux moyens de pérennisation de la profession, et ce sont les éditeurs-libraires qui s’y sont collés.
Offrons-nous donc un petit aparté sur les droits d’auteur de l’époque. Vous allez voir, c’est jobard.
Tout d’abord, « droit d’auteur » est justement une expression apparue à l’époque, en 1838, pour se différencier de la « propriété littéraire » qu’on utilisait jusqu’alors – à économie plus élaborée, droits plus élaborés. L’auteur touchait souvent une somme fixe pour son œuvre, quel que soit le tirage, ou alors il commençait à toucher son argent si son texte connaissait un franc succès. Autant dire que vivre de son travail, au final, c’était déjà pas facile à l’époque.
Bonus : au début, les éditeurs, comme on va le voir bientôt, sont surtout des financiers (et plutôt des incompétents, pour les tous premiers). Du coup, les droits d’auteur sont des actifs comme les autres, et les maisons peuvent se les revendre entre elles sans que l’auteur n’ait son mot à dire.
Bonus bonus : les éditeurs offrent leurs services à la carte, et je ne suis pas sûr que « publier à compte d’éditeur » ait vraiment eu le même sens alors. Un éditeur classique pouvait ainsi proposer un compte d’auteur s’il ne croyait pas trop au texte ou, mieux, ne se charger que de la distribution : à l’auteur de se démerder pour tout le reste.
Pour ne rien vous cacher, à peine le métier d’éditeur apparu, les relations avec les auteurs étaient déjà houleuses. Je vais à ce sujet laisser la parole à Élias Regnault, qui est… un écrivain du milieu et de l’époque (sans déconner, si quelqu’un me trouve sa bio, je suis preneur, je le soupçonne d’être un ninja) :
Jamais l’homme de lettres et l’éditeur ne se placent sur le même terrain. Au moment même où ils s’abordent, ils sont dans des sphères différentes. L’un se présente avec tout l’enthousiasme du poète sur le trépied, l’autre, avec toute la froideur d’un négociant à son bureau. L’un contemple son œuvre avec l’ivresse de la paternité, l’autre l’examine avec l’indifférence d’un teneur de livres.
É. Regnault, « L’éditeur » dans Les Français peints par eux-mêmes
Revenons à nos éditeurs. À quoi ressemblent les premiers spécimens ?
Au début, les maisons n’ont que très peu de spécialisations. Vous pouvez trouver un manuel scolaire à côté de recettes de cuisine et d’un roman d’aventure, ça ne dérange personne. On notera quand même, cas à part, les éditeurs de pièces de théâtre (les gens lisaient autant qu’ils allaient voir les pièces, et on avait donc là des petits fascicules à la limite du chapbook – si vous ne connaissez pas ce terme, j’ai un chouette article pour vous), et ceux dont la spécialité vient de défis techniques : riches illustrations, ou impression au-delà des frontières pour une distribution pourtant nationale dans le cas des textes sujets à la censure.
Cependant, faire tout et n’importe quoi, ça va bien qu’un moment. Les maisons spécialisées dans le scolaire, le religieux, le politique, etc. draguaient leurs propres marchés comme des marie-salopes, obligeant les maisons généralistes à se rabattre sur ce que personne ne voulait car moins rentable que le reste : la littérature. Sic.
Là, on va avoir deux phénomènes en parallèle.
D’une part, les éditeurs dits « de nouveautés » – on dirait de best-sellers à notre époque. Des éditeurs-spéculateurs qui publient que très peu de titres, souvent d’auteurs connus du grand public, et qui font une opé’ com’ d’enfer autour grâce à leur relations dans la presse. Ces enculés étaient les premiers à tenter de faire des buzz viraux de merde et à susciter un engouement artificiel autour de leurs publications. Je leur mets personnellement un pouce rouge. Il se trouve que le karma aussi, parce que la plupart faisaient faillite, ratant leur spéculation.
D’autre part, la presse est, comme on l’a dit tantôt, plutôt florissante. Les propriétaire de journaux veulent augmenter leur lectorat, ce qui leur impose de baisser le prix de vente et de trouver un moyen de fidéliser la clientèle. Vient alors l’idée d’utiliser le bas des pages, appelé rez-de-chaussée ou feuilleton, pour y glisser des romans, épisode par épisode : ainsi naît le roman-feuilleton. Si les premiers romans publiés ainsi, signés Dumas père, Balzac ou Victor Hugo, n’étaient pas pensés pour ce format, le succès fut tel que certains écrivains devinrent des feuilletonistes à part entière. On pensera notamment à Ponson du Terrail, l’auteur du fameux Rocambole, qui donnera avec tant d’autres naissance au genre qu’on connaît aujourd’hui, proche du roman de gare.
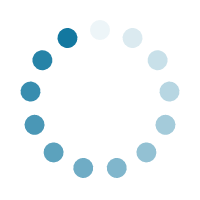
Il pète pas la classe, le Rocambole, là ?
Avec ces deux événements, on a un cocktail propice à l’apparition d’un nouveau genre d’éditeurs, qui ont appris des erreurs des spéculateurs et découvrent que le public est avide de romans et de fictions.
Ce sera donc là les premières maisons d’édition de littérature – on est encore loin des maisons de genres, mais quand même, il faut reconnaître qu’il y a du progrès.
Leur but est simple : constituer des fonds importants de titres de fictions pour se rentabiliser sur le long terme et via un public le plus large possible. Les lecteurs de l’époque verront alors apparaître les premières Collections et les premières Bibliothèques thématiques, qui donnent à une maison son cachet, son identité visuelle, et sa ligne éditoriale. Pensez aux reliures de rouge, d’or et de noir des Voyages extraordinaires de Jules Verne, dont les dos s’alignaient si joliment dans les bibliothèques de nos grands-parents.
Effet bonus pour les auteurs : ces maisons ont besoin de beaucoup de titres, et iront donc chercher davantage de noms que les maisons de nouveautés.
Un très bon exemple de parcours d’écrivain de l’époque est celui du premier recueil de Victor Hugo, tiens, parce qu’il illustre un peu tout ce qui vient d’être dit. Et j’aurais d’ailleurs pu le citer dans mon article sur les débuts modestes des grands illustres.
Première publication en revue, sous forme de feuilleton. Puis il confie ses textes à un imprimeur et le fait ainsi publier à ses frais. Vient ensuite une théorie de petits éditeurs de piètre qualité, qui ne lui donneront pas satisfaction ou feront tout bonnement faillite. Jusqu’à ce que sa notoriété grandisse assez pour qu’un éditeur de renom l’accepte, et qu’il rejoigne un catalogue de qualité, comptant Vigny ou Lamartine dans ses lignes.
D’ailleurs, tous les auteurs ne cherchent pas à rejoindre les grandes maisons. Les petites maisons attirent parfois par leur qualité, leur amour de la littérature, et leur travail bien fait.
Ainsi, pour ses Fleurs du Mal, Baudelaire renonce à Michel Lévy, bonne maison implantée, qui publie tout Balzac, pour s’associer à Poulet-Malassis, plus modeste, connu pour son nom de plat indien son goût pour les textes licencieux et borderline – pour dire si c’était un ouf, il publia des textes interdits alors qu’il était en exil en Belgique.
De même, Urbain Canel était un petit éditeur qui ne comptait pas vingt titres, mais qui publiait les grandes plumes du XIXe siècle et était reconnu pour ses goûts littéraires. True story : le mec n’a pas hésité à financer un voyage à Lamartine et trois autres artistes pour qu’ils rédigent un ouvrage au nom improbable d’Album poétique et pittoresque de quatre voyageurs aux Alpes. Je répète : Canel leur avançait de l’argent pour qu’ils produisent l’œuvre. Bon, malheureusement, sa maison a fait faillite avant la publication, mais l’intention était là : on avait un éditeur qui voulait publier de belles choses, imprimées « avec le plus grand soin sur papier grand raisin vélin et orné de huit gravures dessinées d’après nature […] et gravées par les artistes les plus distingués de l’Europe », comme il le disait lui-même.
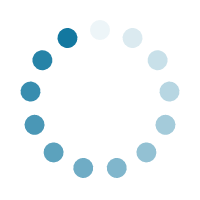
« Moi je me demande quand même s’il était pas un peu con. »
Bref.
Que conclure de tout ce panorama aussi bigarré que bordélique ?
Personnellement, je crois qu’on peut dire que le paysage éditorial et littéraire actuel est l’héritier direct de celui qui s’est formé durant le XIXe siècle. On retrouve les mêmes problématiques et les mêmes dichotomies qui se sont formées durant ces quelques décennies de transformation : de grandes maisons industrielles qui visent les best-sellers et de petites artisanales qui font ça par amour des Lettres ; des auteurs qui râlent sur des éditeurs et réciproquement ; des livres-objets en jolies reliures de cuir et des textes publiés là où on peut, là où il y a de la place pas chère, etc.
Alors, que deviendra le monde éditorial dans les prochaines décennies ? Pour être franc, je n’en sais trop rien. Mais si on regarde bien les deux révolutions du livre déjà passées, qui ont chacune eu des impacts structurants sur la littérature, on constate qu’elles sont nées de changements essentiellement technologiques : les caractères mobiles de Gutenberg, l’industrialisation des process de l’imprimerie. Dès lors, là encore, avec l’évolution numérique qui est en cours, on peut s’attendre à terme à de nouveaux paradigmes.
Sinon, pour ceux que ça intéresse, voici quelques unes des sources de l’article, que j’ai pompées sans vergogne :
- Auteurs et éditeurs de littérature au XIXe siècle, par Élisabeth Parinet
- Histoire de l’édition française #3 : le Temps des éditeurs du Romantisme à la Belle époque, par Nicole Le Pottier
- Naissance de l’éditeur, par Thomas Mercier
- l’article « Maison d’édition », sur Wikipédia
Et je vous laisse avec cette guerrière de Ahmad Samy, qui claque sévère !

Comte de X
décembre 18, 2015 at 10:16« je suis auteur SF, je peux »
J’adore :)
Sinon, article vraiment intéressant.
Escrocgriffe
juin 27, 2018 at 9:54Coucou Xavier, je découvre tardivement ton blog, qui est vraiment passionnant. Je suis d’accord avec la conclusion de cet article, avec un micro-bémol pour ce passage :
» de grandes maisons industrielles qui visent les best-sellers et de petites artisanales qui font ça par amour des Lettres »
Je suis peut-être pessimiste, mais je pense, hélas !, que la réalité est plus nuancée. J’ai constaté, à plusieurs reprises, qu’on trouvait aussi de petites maisons artisanales qui visent les best-sellers avant même l’amour des livres…