J’aurais aussi pu faire un titre avec un jeu de mots sur les états d’âme, mais vous ne l’auriez compris qu’à la fin de l’article. Bref, passons et attaquons le vif du sujet : aujourd’hui, ça va parler limite de la conscience et incarnation physique du langage.
Il y a fort peu, j’ai écrit une nouvelle dont le personnage narrateur est ce que j’ai baptisé (sans grande originalité) un synth, à savoir une conscience humaine dans un corps humanoïde artificiel. Entendons-nous bien, car c’est important pour la suite : ce n’est ni un robot, ni une IA. Juste un esprit, humain – avec ce que ça implique d’émotions et de sentiments – mais dans le crâne d’un corps de silicone.
En écrivant ce texte, je me suis retrouvé confronté à un sacré obstacle : comment retranscrire les émotions du héros ? Comment faire du show (don’t tell) bien comme il faut ?
Un tel personnage ne serre pas les dents lorsqu’il est en colère. Son cœur ne bat pas plus vite quand il a peur. Il n’a ni goutte de sueur quand il fait chaud ni frisson quand il a froid. Bref, c’est la merde à décrire.
De là l’idée de pondre un article sur ma marotte préférée, j’ai nommée la conscience.
Avant d’aller plus loin, il va me falloir vous présenter deux théories qui n’ont rien à voir avec la littérature. Et tant qu’à digresser, dans la foulée, je vous conseille de relire mon vieil article sur la métaphore, cette figure qui a du style, car on va en avoir besoin.
La première de ces deux théories, c’est l’embodied cognition (« cognition incarnée » en français, je crois, mais certainement pas embodiment comme voudrait nous le faire croire Wikipedia). Dans les grandes lignes, c’est une hypothèse qui s’oppose au dualisme corps / esprit de Descartes, et qui affirme que notre esprit est conditionné par la nature de notre corps – dans sa façon de penser, dans ses facultés et ses limites, ou encore dans son réseau de symboles. Pour citer Francisco J. Varela :
D’une part, la cognition dépend de la nature des expériences qui viennent avec le fait de posséder un corps muni de capacités sensorimotrices. D’autre part, ces capacités sensorimotrices sont elles-mêmes intégrées dans un contexte global biologique, psychologique et culturel.
Dit bêtement, notre conscience sait gérer l’ouïe et la vue tout simplement parce que nous avons des oreilles et des yeux, et ne sait pas gérer les champs magnétiques terrestres parce que notre corps ne dispose d’aucun organe qui y serait sensible. Rien de bien sorcier, en somme.
Mais ce n’est pas tout : la dépendance à notre corps s’étend évidemment en cascade, et concerne donc également notre faculté de penser (i.e. de manipuler des concepts mentaux), nos réseaux de symboles culturels, et en fin de compte notre langage lui-même.
Pour l’expliquer d’une manière très, très caricaturale, si nous avons des mots pour désigner les couleurs, c’est car nous savons les percevoir. Si nous n’avons d’ailleurs qu’un mot pour le jaune alors qu’il peut être le résultat de deux combinaisons du spectre lumineux (jaune ou rouge + vert), c’est parce que nous ne savons pas faire la différence. Mais aussi : si nous mettons le paradis dans le ciel, c’est parce que nous ne savons pas voler. Si nous assimilons la nuit à l’inconnu et les ténèbres à la peur, c’est parce que nous ne sommes pas nyctalopes. Et si la chaleur est associée au confort, c’est tout bêtement dû au fait que nous sommes des animaux à sang chaud qui pouvons mourir de froid.
Ça paraît très con, dit comme ça, mais ça permet de souligner quelque chose qu’on a tendance à oublier, sinon à ne jamais réaliser : les symboles que nous manipulons ne sont pas absolus, ils découlent de tout un contexte culturel, psychologique et, en définitive, physique.
Passons maintenant à la deuxième théorie.
Nous la devons à Thomas Nagel, un philosophe qui a initié un vaste mouvement de pensée avec son célèbre article What is it like to be a bat? (pdf) (« Quel effet cela fait-il d’être une chauve-souris »). Je vous en recommande chaudement la lecture : ça ne fait qu’une demi-douzaine de pages, c’est plutôt accessible pour qui parle l’anglais, et c’est franchement bien expliqué.
Dans cet article, Nagel formalise le problème de l’irréductibilité de la conscience : je ne peux pas savoir ce que ça fait d’être vous, et réciproquement. Il prend ainsi l’exemple d’une chauve-souris qui jouit, notamment, de l’écholocalisation, cette faculté de percevoir le relief de son environnement à l’aide des sons. Un être humain est irrémédiablement incapable de savoir ce que ça fait que de posséder un tel sens : on peut bien se dire « c’est comme un sonar », ou « ça fait un peu comme la vision, mais avec des ondes sonores », on peut mettre plein de mots dessus, mais on sera toujours contraint de passer par des comparaisons, par des « c’est comme ceci ou comme cela », et jamais, jamais, on ne pourra décrire parfaitement ce que c’est avec des sens qui nous sont propres. C’est exactement comme vouloir décrire les couleurs à un aveugle de naissance, ou la différence perçue entre un jaune pur (lumière à 570nm) et un jaune composé (rouge à 640nm et vert à 500nm).
Ce problème est inhérent aux qualia, ces propriétés de la perception qui font qu’on voit le rouge rouge, qu’on entend les sons alors qu’on voit les couleurs, et toutes ces choses. Les qualia sont par définition ineffables : vous ne pouvez pas les décrire autrement que par des tautologies ou des auto-références. Du coup, impossible de retranscrire des qualia que vous n’êtes pas capables de ressentir vous-mêmes.
Et maintenant, il est temps pour moi de relier tous les morceaux de cet article.
Les deux idées citées sont les deux facettes d’un même concept : notre conscience et notre langage dépendent de notre corps, et nous ne pourrons jamais connaître ce que ça fait d’être dans un autre corps que le nôtre.
D’où le titre de cet article : les écrivains humains ne peuvent évoquer que ce que vivent d’autres humains, et ne peuvent être compris que par d’autres humains.
Là, en principe, vous devriez me dire « Mais Xavier, c’est vilainement évident, tout ça. Est-ce que ça méritait un article si long, dans lequel tu enfonces tellement de portes ouvertes qu’on se croirait à une journée portes ouvertes ? »
Tout d’abord, je vous répondrai que c’est un très mauvais jeu de mots.
Ensuite, il ne faut pas s’arrêter à ce constat. En regardant les personnages sur les couvertures bigarrées des bouquins empilés sur nos étagères, on est en droit de se poser la question suivante : dans ce cas, pourquoi écrivons-nous tant d’histoires qui embrassent le point de vue d’elfes, de mages ou de robots ? Est-ce que ce n’est pas forcément voué à l’échec ?
La réponse est évidemment non, j’ai même envie de dire que c’est tout le contraire. Tout cet article n’est d’ailleurs au final qu’un plaidoyer en défense des genres de l’imaginaire, et qui étaie cet argument en faveur de la SFFF que j’aime beaucoup : mettre en scène des personnages d’autres espèces nous aident à mieux cerner les limites de la nôtre.
Alors oui, si une chauve-souris super intelligente venait à lire votre roman où l’héroïne est une chauve-souris redresseuse de torts, elle trouverait certainement mauvaises vos descriptions des émotions de Battavia, la roussette vengeresse assoiffée de justice et de petits insectes. Tout comme un synth rirait de mes tentatives d’introspections robotiques en lisant ma nouvelle.
Mais on s’en fout. On écrit pour des humains de chair et de sang. Et décrire de l’intérieur comment fonctionnent les sentiments d’un robot, avec nos propres mots, ça nous aide à mieux cerner comment marchent les nôtres. Et retranscrire une course-poursuite d’un point de vue presque aveugle mais capable de découvrir les reliefs de l’environnement par petits cliquetis, ça nous apprend à redéfinir nos propres sens. La meilleure manière de découvrir les frontières de notre nature humaine, c’est encore en essayant de la franchir.
Alors, évidemment, pour y arriver, nous recourons à la métaphore, par pack de douze même. J’avais déjà dit dans un ancien article tout le bien que j’en pensais, et je n’ai pas changé d’avis, encore moins quand on sait que des penseurs comme George Lakoff avancent l’hypothèse que tout notre langage est métaphorique. Nous appréhendons notre environnement au travers d’un vaste réseau de symboles construits sur les analogies et les similitudes, nous recourons aux métaphores pour abstraire, pour formaliser, bref pour concevoir.
Dès lors, dans l’exercice subtil de décrire ce qui ne peut nous être décrit, la littérature me paraît de loin le meilleur medium dont nous disposons. Dans un texte, l’auteur manipule le langage même et nous offre des mots, bruts, sans autre barrière perceptive que la lecture, sans aucun filtre analytique. Le langage est le matériau premier de la pensée, le socle avec lequel nous nous représentons nos expériences, alors quoi de plus naturel que de l’utiliser, lui et lui seul, pour tenter de dépeindre une conscience étrangère et, ce faisant, mettre en lumière les différences avec la nôtre, sinon ses forces et ses limites.
Alors, quelle conclusion tirer de ces constats ?
Peut-être qu’il serait bon, en tant qu’auteur mais aussi en tant que lecteur, de faire attention à tout ça quand on parle d’individus non-humains. Se rappeler qu’un elfe quasi-immortel n’aura pas la même vision de la mort, qu’un nain de la Moria ne verra pas le ciel de la même façon, et qu’un androïde n’inspectera pas une allée ténébreuse avec pour seul outil un spectre lumineux affreusement réduit.
Peut-être que nous devrions prendre garde à ne pas trop anthropomorphiser nos personnages, afin de nous apprendre à cesser de mesurer le monde qui nous entoure uniquement à l’aune de l’être humain.
Parce que nous sommes probablement à l’aube d’une époque où les frontières de notre condition charnelle vont être constamment bouleversées, et qu’il serait bon de nous y préparer.
Et pour rester dans le ton de cette conclusion, les illustrations du jour sont une petite troupe de roboïdes illustrés par Mole Wang sur ArtStation.
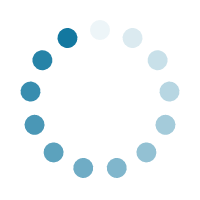

Amaryan
avril 11, 2016 at 12:01Merci pour ces réflexions sur ce sujet passionnant, à mes yeux central en sfff ! Une autre approche que je trouve intéressante, outre tenter de se plonger dans la psyché d’un individu non-humain, est celle de Stanisław Lem dans Solaris qui confronte son héros humain à son incapacité d’envisager une forme d’intelligence radicalement différente.
Xavier
avril 11, 2016 at 1:13Je note la référence dans ma PAL, le résumé me semble plutôt intéressant, merci :)
Ivan
avril 12, 2016 at 1:23Chouette article !
Je trouve intéressant que les exemples que tu donnes à la fin (vision de la mort d’un elfe millénaire, symbole du ciel pour un nain des undergroundz, etc.) sont avant tout des différences culturelles et non des considérations fondamentales soulignant la différence de nature entre un elfe, un nain et un humain.
Un esprit taquin arguerait que tu es déjà dans l’anthropomorphisation ici.
Maintenant pour me faire l’avocat du diable, j’aimerais aborder une autre idée de la conscience qui n’est englobée dans aucune de celles que tu cites : et si l’esprit n’existait tout simplement pas ? Si la conscience n’était rien de plus qu’une sensation prodiguée par nos circuits neuronaux, comme un vulgaire Windows gravé dans le silice ?
A cette aune-là, l’expérience d’un robot (dont la conscience n’est que software) ne serait pas si différente de la nôtre mais se limiterait simplement à un écart dans les aptitudes sensorielles.
Xavier
avril 12, 2016 at 8:48J’avoue que pour les différences à la fin, j’ai pris la facilité, j’étais fatigué de parler des qualia – pour lesquelles on n’a que très peu de mots, et qui obligent donc plein de répétitions :-/
Quant à la non-existence de la conscience, j’ai évité d’en parler parce que ce blog est littéraire, il paraît, et ç’aurait été un peu HS du coup :)
Cela dit, c’est la thèse de Daniel Dennett, qui la considère comme une « illusion ». Je ne m’avancerai pas à critiquer son argumentaire car je ne me suis pas assez penché dessus pour pouvoir prétendre le comprendre.
Il y a tout de même des points sur lesquels je suis en accord avec lui, notamment le fait que le monde physique impacte la conscience mais que l’inverse n’est pas vraie : tu pourrais être un logiciel sans conscience qui renverrait les mêmes outputs aux mêmes inputs que toi, ça serait pareil – ce qu’on appelle un « zombie philosophique ».
Les conséquences de ce genre de questions ne sont d’ailleurs pas neutres. En fait, on ne sait toujours pas très bien ce qu’est la conscience, dès lors on ne sait pas si un zombie philosophique est une possibilité ou si, au contraire, toute chose (biologique ou non) est plus ou moins consciente. C’est l’argument de David Chalmers qui prône le proto-panpsychisime (l’idée que la conscience est une caractéristique fondamentale du monde physique, au même titre que l’énergie ou la position), mais il ne fait au final que déplacer le problème :-/
Quoi qu’il en soit, je pense te rejoindre sur ta conclusion. Personnellement, je ne prête aucune magie à la conscience biologique, et j’accepte l’idée éventuelle que qu’une conscience du même type que la nôtre puisse se retrouver dans des systèmes informatiques. Je n’ai aucun argument contre ça, bien au contraire :)
Cedricg
avril 16, 2016 at 8:50Merci pour les idées et les caveats à éviter dans nos récits. Je rêve d’un roman qui décrivait une conscience totalement non humaine et cohérente, mais d’après les théories exposées ici on a peut être bien un mur infranchissable, et ce n’est pas un problème d’imagination. J’essaierai quand même.